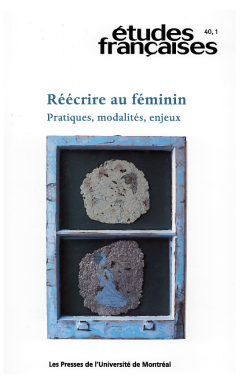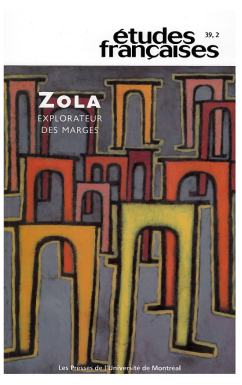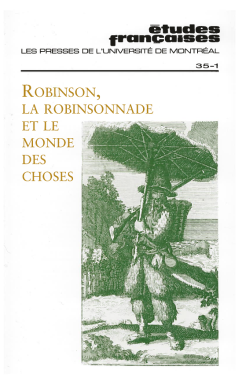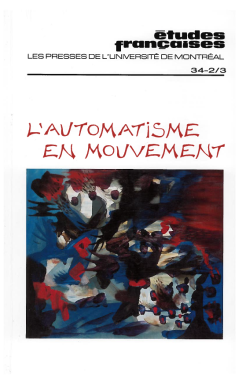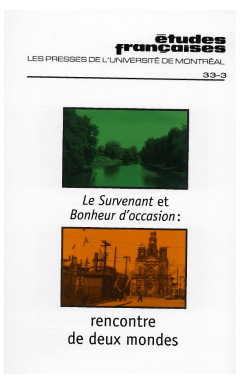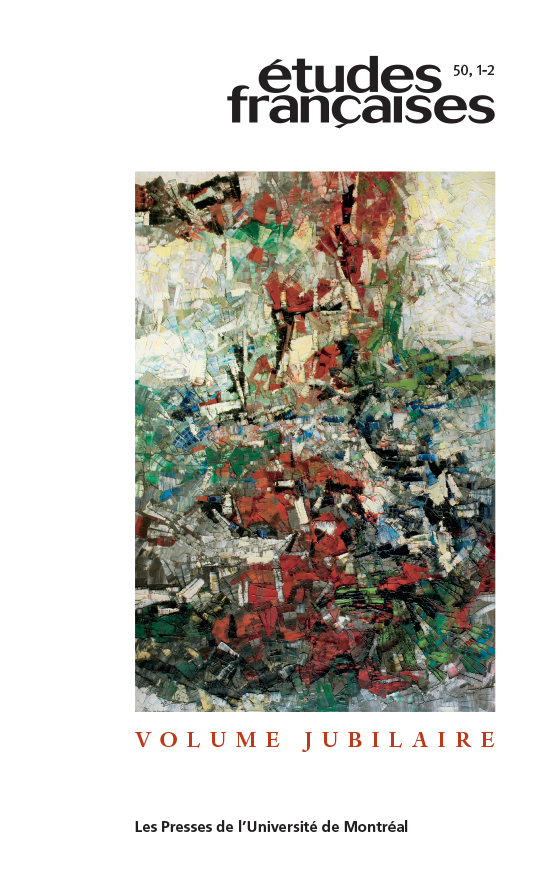
Volume jubilaire
Volume 50
Numéro 1-2
2014
192 pages
[En ligne]Commander
Résumé
Les anniversaires offrent d’utiles temps d’arrêt pour se situer par rapport au passé et s’interroger sur ce que pourrait être le futur. La parution du cinquantième volume d’une revue universitaire, phénomène encore assez rare dans l’histoire de l’édition savante au Québec, a semblé un heureux prétexte pour consacrer la totalité de ce volume au rôle que la revue Études françaises a joué dans la vie littéraire québécoise et pour envisager l’avenir en insistant sur la place de notre revue dans la Cité au moment où des changements importants s’opèrent dans les modes de diffusion de la connaissance. Le numéro double qui ouvre ce volume jubilaire est ainsi entièrement consacré au prix de la revue Études françaises et à ses lauréats qui ont répondu de manière assez exceptionnelle à la mission que se donnait explicitement la revue d’être « un lieu où la littérature se fait ». La qualité des lauréats du prix constitue la meilleure preuve que la revue remplit parfaitement le rôle que lui fixait son premier directeur, René de Chantal, d’être « au centre de gravité » de toutes les cultures d’expression française.
Numéro préparé par Francis Gingras
Table des matières
Ce numéro est disponible pour achat en format epub, notamment sur les sites Les libraires, librairie Gallimard de Montréal, Amazon et Decitre.